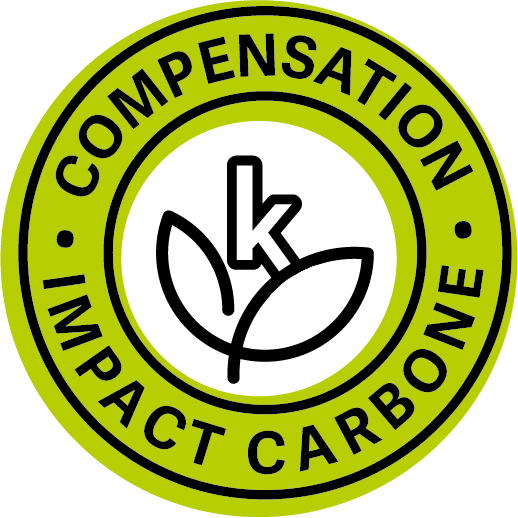Un parcours sur mesure pour un avenir Assuré !
Le CFA Trajectoire te propose de nombreuses possibilités de carrière dans 9 secteurs d’activité différents !
Découvrez parmi nos nombreuses formations en apprentissage celle qui vous convient le mieux.
Bienvenue sur le site du CFA Trajectoire
Votre passerelle vers un avenir professionnel prometteur dans une large variété de secteurs d’activité !
Nous offrons une gamme complète de formations spécialisées dans les domaines de l’accueil, du commerce, de la gestion, de l’alimentation, de la cuisine, de l’hôtellerie et restauration, de l’informatique, de la maintenance et du bâtiment, de la sécurité, du soin et santé, ainsi que du tourisme.
Au CFA Trajectoire, nous proposons un parcours sur mesure pour aider nos apprenants (jeunes et adultes) à réaliser leur objectif professionnel.
Que vous cherchiez à exceller dans le secteur de l’accueil, à construire une carrière prospère dans le commerce ou la gestion, à dévoiler votre passion pour l’alimentation et la cuisine, à prospérer dans l’industrie hôtelière et de la restauration, à faire avancer la technologie dans le secteur de l’informatique, à maintenir et rénover des infrastructures en tant que professionnel de la maintenance et du bâtiment, à garantir la sécurité d’autrui, à apporter votre contribution au secteur du soin et santé ou encore à explorer le monde passionnant du tourisme, nous avons la formation qu’il vous faut.
Nos formations sont proposées en apprentissage pour les jeunes ou en formation continue pour les adultes, s’adaptant à votre style d’apprentissage et à votre emploi du temps. Nous nous engageons à fournir un environnement d’apprentissage inclusif et accessible. Tous nos sites de formation sont équipés pour accueillir des personnes en situation de handicap.
Avec nos établissements répartis principalement dans le département des Yvelines et également en Essonne et les Hauts de Seine, nous sommes toujours à portée de pieds pour soutenir votre parcours de formation. Nos sites sont localisés à Guyancourt, Saint-Cyr-l’École, Trappes, Le Chesnay, Les Mureaux, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Versailles, Rueil-Malmaison et à Draveil.
Le CFA Trajectoire a été créé en 1993 grâce à une initiative conjointe du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Région Île-de-France et de diverses entreprises. Depuis lors, nous formons plus de 1000 apprentis chaque année et avons aidé de nombreux adultes en reconversion à retrouver un chemin gratifiant vers l’emploi.
Nous sommes fiers de notre équipe de 300 professionnels dévoués qui apportent une richesse de connaissances et qualité d’expérience à nos formations.
Que vous cherchiez à obtenir un CAP, un BAC PRO, un BTS, un Bachelor ou encore à suivre une formation continue,
notre équipe est là pour vous guider.
Embarquez pour votre parcours vers le succès avec le CFA Trajectoire. Ensemble, nous réaliserons vos objectifs professionnels. Bienvenue dans notre famille, bienvenue au CFA Trajectoire !
Les secteurs d'activités :
Accueil, Commerce, Gestion, Immobilier
Alimentation, Traiteur
Boulangerie, Pâtisserie
Cuisine, Hôtellerie, Restauration
Informatique
Maintenance et bâtiment
Sécurité
Soin, Santé, Esthétique
Tourisme
Réalisez vos objectifs professionnels
Comme Ibrahim, visez l’excellence en suivant nos parcours de formations spécialisés. Le prix de la formation professionnelle lui a été remis lors de la cérémonie des 91 d’or pour son parcours d’exception.

En savoir +
Nos sites de formation
Tous nos établissements peuvent accueillir des personnes en situation de handicap.

UFA du Lycée Hôtelier
Guyancourt (78)

UFA du Lycée Nadar
Draveil (91)

UFA du Lycée Jean Perrin
Saint-Cyr-l'École (78)

UFA du Lycée Blériot
Trappes (78)

UFA du Lycée Jean Moulin
Le Chesnay (78)

UFA du Lycée Léopold Sédar Senghor
Magnanville (78)

UFA du Lycée Vaucanson
Les Mureaux (78)

Campus Odyssée Formation
Guyancourt (78)

UFA du Lycée Bascan
Rambouillet (78)

UFA du Lycée Jean Rostand
Mantes-la-Jolie (78)

UFA du Lycée Jacques Prévert
Versailles (78)

UFA du Lycée Gustave Eiffel
Rueil-Malmaison (92)
Nos actualités • Articles
Découvrez les dernières actualités du CFA Trajectoire ainsi que les dates des différents salons où seront présents nos développeurs de l’apprentissage.
- mars 2024
Soutenez les Apprentis en BTS Tourisme du CFA Trajectoire au Concours Olympic’tur !
Nous sommes fiers d’annoncer que nos apprentis en BTS Tourisme représentent brillamment le CFA Trajectoire au concours Olympic’tur ! Vous avez jusqu’au 14 mars pour soutenir notre vidéo. Retrouvez dès maintenant les 18 vidéos en compétition en cliquant sur « Vote » pour le concours Olympic’ture. Nous vous encourageons vivement à demander à votre entourage de voter […]
[...]Les derniers articles
- mars 2024
Opportunités de Carrière dans l’Hôtellerie et la Restauration Haut de Gamme à Versailles
Rejoignez-nous maintenant !
Les candidatures pour 2024 seront ouvertes à partir du mois de février ! Nos formations associées à l’expérience que donne l’apprentissage vont vous permettre de vous lancer dans votre carrière. Notre objectif est de vous accompagner vers votre réussite !
La combinaison formation/expérience professionnelle est le meilleur moyen de grandir et de mûrir, en découvrant les domaines qui vous passionnent et en avançant par étape.
Nous attachons beaucoup d’importance à votre épanouissement.
Ensemble trouvons la filière qui VOUS ressemble !
FAQ
L’apprentissage est une forme spécifique d’alternance dans laquelle l’étudiant signe un contrat d’apprentissage avec une entreprise. Ce contrat peut durer de 1 à 3 ans et l’étudiant est salarié de l’entreprise. En revanche, l’alternance peut prendre différentes formes, comme le contrat de professionnalisation ou la période de professionnalisation.
L’apprentissage est réservé aux jeunes âgés de 15 ans sortis de 3ème, et de 16 ans à 29 ans.
Plus largement, l’alternance est ouverte à tous les publics, y compris les adultes en reconversion professionnelle.
Quel est l’âge minimum ?
L’âge minimum est de 16 ans, correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils ont accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire (jusqu’à la fin de 3e).
Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent s’inscrire, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou un CFA pour commencer leur formation en apprentissage dès lors qu’ils ont achevé leur scolarité au collège.
Quel est l’âge maximum ?
L’apprenti doit avoir moins de 30 ans à la date de conclusion. Toutefois, deux dérogations sont possibles jusqu’à 34 ans inclus :
- lorsque le contrat fait suite à un 1er contrat et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu ;
- lorsque le contrat fait suite à une rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations, inaptitude physique et temporaire de l’apprenti).
Dans ces deux cas, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat.
Quatre autres dérogations sont prévues sans limite d’âge, lorsque le contrat est conclu par une personne :
- Reconnue travailleur handicapé ;
- Ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
- Inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé des Sports ;
- qui a échoué à l’examen du diplôme ou du titre professionnel visé : dans ce cas, le contrat initial peut être prorogé pour 1 an maximum ou un nouveau contrat peut être conclu avec un autre employeur pour 1 an maximum.